Volume 1 : Au-delà de l’horizon : les intérêts et l’avenir du Canada dans l’aérospatiale – Novembre 2012
Partie 2
Contexte (suite)
Chapitre 2.2
Tendances mondiales
L'industrie aérospatiale canadienne doit s'adapter à la conjoncture mondiale en rapide évolution qui influera sur les réalités du marché et de la production au cours des 20 à 30 prochaines années. En fermant les yeux sur ces facteurs ou en réagissant de façon inadéquate ou tardive, nous mettrions en péril notre industrie et son apport à la prospérité et à la sécurité du Canada.
Les principales tendances qui se manifestent sont les suivantes :
- Rééquilibrage mondial. Nous observons une augmentation rapide de la puissance économique et géopolitique de régions et de pays autres que ceux qui ont dominé au cours de la deuxième moitié du 20e siècle. La Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et d'autres puissances montantes en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique emboîtent le pas à l'Amérique du Nord, à l'Europe et au Japon. Nombre de ces pays sont populeux, vastes, ambitieux sur le plan géopolitique et disposés à tirer parti des pouvoirs et des ressources de l'État pour développer des industries considérées comme ayant une importance stratégique.
Figure 5 : Part du PIB mondial, de 2000 à 2020
 Source : IHS Global Insight.PIB = produit intérieur brut
Source : IHS Global Insight.PIB = produit intérieur brut - Besoins en ressources naturelles et en production agricole. À mesure que des centaines de millions de personnes passent d'une économie rurale et de subsistance à un mode de vie plus urbain de classe moyenne, on constate une augmentation considérable de la demande en combustibles, en matières premières à partir desquelles sont fabriqués les biens de consommation, en eau et en nourriture.
Figure 6 : Consommation mondiale d'énergie, de 1990 à 2035
 Source : Energy Information Administration des États-Unis.OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques
Source : Energy Information Administration des États-Unis.OCDE = Organisation de coopération et de développement économiques - Changements climatiques et préoccupations environnementales. L'inquiétude croissante suscitée par les effets des changements climatiques et les autres problèmes environnementaux — notamment la qualité de l'air et la pollution sonore — suscitent des changements dans le comportement des consommateurs, dans les programmes de réglementation et dans la conduite des entreprises partout dans le monde.
Diminution des glaces marines dans l'Arctique, 1979 et 2011
Étendue des glaces


- Réduction des dépenses de défense et nouvelles menaces non conventionnelles à la sécurité. Dans un climat de restrictions financières, les pays occidentaux réduisent leur budget de défense, tandis que les responsables de la planification de la sécurité nationale concentrent de plus en plus leurs efforts sur la gestion des menaces non conventionnelles en plus des risques inhérents à la guerre traditionnelle.
- Révolution numérique. Nous sommes au cœur d'une véritable révolution des communications déclenchée par l'augmentation exponentielle de la puissance informatique, l'avènement de la technologie sans fil et une explosion des médias sociaux. Les effets économiques, sociaux et politiques sont déjà profonds — et ce n'est qu'un début.
- Vieillissement de la population. Les changements démographiques créent de nouveaux défis — et nécessitent de nouvelles stratégies — pour les entreprises qui doivent compter sur une main-d'œuvre très instruite et hautement qualifiée.
Ces tendances ont des répercussions considérables pour l'industrie aérospatiale mondiale et canadienne.
Le rééquilibrage à l'échelle de la planète a accéléré la mondialisation de l'industrie proprement dite. Il ne s'agit pas d'un phénomène entièrement nouveau ou limité à l'aérospatiale, mais les chaînes de production transnationales — où on fabrique les systèmes et les composants sur différents continents pour centraliser l'assemblage — sont devenues la norme, à mesure que les nouveaux venus se dotent d'installations de production de plus en plus modernes. La mondialisation de la production d'aéronefs reflète en partie un simple impératif concurrentiel, les avionneurs parcourant la planète à la recherche de fournisseurs qui offrent au plus bas prix les produits les plus évolués sur le plan technologique. Mais elle reflète aussi les considérations relatives à l'accès aux marchés, car la production dans le pays acheteur peut parfois présenter un avantage — voire une condition préalable — pour une entreprise qui espère réaliser des ventes dans des marchés en pleine croissance.
Et les marchés sont en croissance, malgré l'incertitude économique à l'échelle mondiale. Selon les estimations de Boeing, les compagnies aériennes auront besoin d'environ 34 000 nouveaux avions commerciaux, soit une valeur de 4,5 billions de dollars, au cours des 20 prochaines années. La moitié de ces ventes se feront dans les nouveaux marchés asiatiques — en particulier la Chine et, dans une moindre mesure, l'Inde —, au Moyen-Orient et en Amérique latine. Dans toutes ces régions, la prospérité de plus en plus grande suscitera une forte croissance du transport aérien de passagers — pour les voyages d'affaires et d'agrément — et de marchandises.
Les pays en plein essor ne se contentent pas de fournir des pièces aux entreprises aérospatiales mondiales et d'être leurs clients. Déterminés à devenir eux-mêmes des puissances dans le domaine, ils investissent énormément dans leur industrie pour concrétiser cette ambition, si bien que les pays établis dans l'industrie aérospatiale affrontent une concurrence supplémentaire. Ces nouveaux joueurs bénéficient de coûts de production relativement faibles sur leur territoire et sont en voie de rattraper rapidement les entreprises occidentales sur le front de l'évolution technologique. Ainsi, la Russie construit le Superjet 100, dans le segment des avions à réaction de transport régional, que Bombardier et Embraer dominent à l'heure actuelle, tandis que l'ARJ21, appareil chinois de taille similaire, devrait entrer en service à la fin de 2013. Les deux projets ont connu des problèmes techniques et des retards, mais la Russie et la Chine ont redoublé d'efforts, et ils déploieront des modèles supplémentaires au cours des 20 prochaines années. D'autres pays, de l'Ukraine au Mexique, présentent des offres conjointes pour construire leurs prochains avions ou se tailler une place dans les segments à grande valeur ajoutée des chaînes d'approvisionnement mondiales en aérospatiale.
En résumé, pour les puissances aérospatiales bien établies comme le Canada, le rééquilibrage mondial se traduit par de nouveaux clients, de nouveaux partenaires et de nouveaux concurrents. Il en a résulté un marché et un environnement de production dynamiques et plus complexes présentant un éventail de possibilités et de risques nouveaux et différents.
Figure 7 : Livraisons d'avions commerciaux prévues dans le monde par région, de 2012 à 2031

Livraisons prévues
Si le rééquilibrage mondial modifie la façon dont les avions sont construits et vendus ainsi que l'endroit où ils le sont, le changement climatique et les préoccupations environnementales influent sur les caractéristiques des appareils eux-mêmes. Les compagnies aériennes doivent respecter des normes d'émissions plus strictes que jamais, faire face au prix élevé du carburant, et composer avec les réactions du public contre les traînées de condensation dans le ciel et le bruit dans les villes. Dans un secteur d'activité caractérisé par des marges bénéficiaires faibles et une réglementation stricte, la demande porte sur des avions plus légers, plus aérodynamiques et plus silencieux, dotés de moteurs à plus faible consommation de carburant.
Par ailleurs, la nouvelle conjoncture mondiale, le changement climatique et l'évolution des priorités gouvernementales entraînent le désenclavement des régions polaires, en particulier le Nord canadien, stimulant ainsi l'extraction des ressources et d'autres projets de mise en valeur à des endroits qui ne sont pas facilement accessibles par transport terrestre ou maritime. Une gamme d'avions — depuis les appareils turbopropulsés à décollage et atterrissage courts jusqu'aux dirigeables modernes — pourrait s'avérer la meilleure option, voire la seule, pour y transporter les passagers et l'équipement, d'autant plus que le pergélisol fond et que le transport de surface devient de plus en plus difficile et cher. En outre, les entreprises qui souhaitent repérer l'emplacement des ressources naturelles auront besoin à la fois d'avions pilotés et de drones pour faire le levé de vastes zones inhabitées. À mesure que l'économie dans le Nord croîtra et que les collectivités de cette région prendront de l'expansion, on aura aussi de plus en plus besoin d'activités liées à la protection de la population, des biens et de l'environnement — pour lesquelles les technologies, les produits et les services aérospatiaux conviennent particulièrement bien compte tenu des caractéristiques géographiques et topographiques de cette région.
À la différence des prévisions de croissance positive pour les marchés de l'aérospatiale civile, le segment militaire de l'industrie se heurte à une réduction des dépenses de défense attribuable aux pressions financières. Les plus proches alliés du Canada, soit les États-Unis et l'Union européenne, qui effectuent collectivement près des deux tiers des dépenses militaires mondiales, réduisent leur budget militaire. La baisse de la demande de produits aérospatiaux à usage militaire pourrait se propager au secteur civil, car les entreprises exercent souvent leurs activités dans les deux segments, et utilisent des technologies développées à des fins miliaires pour améliorer les produits et services commerciaux qu'elles offrent.
Le nouveau contexte de sécurité signifie aussi que les gouvernements recherchent de nouveaux équipements pour faire face aux menaces non conventionnelles à la sécurité, entre autres les activités de groupuscules militants entourés du plus grand secret. Ces menaces nécessitent une surveillance plus efficace des frontières et des océans, ainsi qu'une capacité de frappe rapide et précise dans des régions éloignées. Les technologies aérospatiales sont essentielles pour répondre à ces besoins, comme en témoigne, par exemple, l'expansion rapide de l'utilisation de drones de plus en plus efficaces et relativement peu chers.
Recours croissant aux drones
De plus en plus de pays, dont le Canada, ont maintenant recours à des véhicules aériens sans pilote, c'est-à-dire des drones, à des fins commerciales et militaires. Le nombre de drones du département de la Défense des États-Unis est passé de 167 en 2002 à près de 7 500 en 2010.
Le ministère de la Défense nationale du Canada utilise différents drones, par exemple le Heron et le ScanEagle, pour toute une gamme d'applications, notamment la patrouille côtière, la cartographie et la collecte du renseignement. En outre, Recherche et développement pour la défense Canada — Suffield, en Alberta, teste actuellement des drones à la fine pointe pour répondre aux besoins futurs des Forces canadiennes.
On utilise également des drones dans les Prairies pour surveiller la santé des cultures, par exemple le niveau de nutriments et d'humidité. La Gendarmerie royale du Canada y a aussi recours pour faire enquête sur les lieux d'accidents. On prévoit également d'y faire appel pour améliorer la surveillance des oléoducs et des gazoducs et des frontières du Canada.


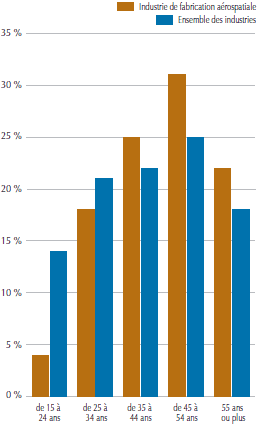
Source : Statistique Canada.
La nouvelle donne à l'échelle mondiale comporte un pouvoir de transformation. Elle crée davantage de possibilités, mais aussi davantage de risques, et établit un nouveau contexte mondial où l'industrie aérospatiale doit respecter des normes de rendement plus strictes pour rester dans la course. Si les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, les syndicats et les gouvernements font preuve de discernement et de détermination en évoluant dans cette nouvelle conjoncture, le secteur pourra en ressortir plus fort. Une réaction faible ou ambivalente pourrait toutefois se traduire par des pertes irréversibles pour l'industrie et le pays dans son ensemble.