Volume 2 : Vers de nouveaux sommets : les intérêts et l'avenir du Canada dans l'espace – Novembre 2012
Partie 2
Contexte (suite)
Chapitre 2.2
Le Canada dans l'espace
La conquête de l'espace a débuté il y a 55 ans, quand Spoutnik a fait son premier tour de la Terre. Le Canada a fait son entrée dans l'ère spatiale il y a 50 ans. Avec le lancement du satellite Alouette-I le 29 septembre 1962, le Canada est devenu la troisième nation à avoir mis en orbite un satellite fabriqué au pays. Alors que les États-Unis et l'Union soviétique se sont livrés à une course à l'espace alimentée par une rivalité géopolitique, le Canada a fait preuve de perspicacité, motivé par l'idée que les satellites pourraient jouer un rôle crucial en développant un pays vaste, peu densément peuplé, et en reliant ses habitants.
Cette idée est plus pertinente que jamais.

Quand Alouette-I a été placé en orbite, le premier ministre John Diefenbaker a loué les réalisations scientifiques des ingénieurs et des travailleurs qui avaient conçu et construit le satellite; il a souligné les fins pacifiques et pratiques auxquelles servirait Alouette, ainsi que la collaboration transfrontalière avec les États-Unis — lesquels ont offert des services de lancement pour le satellite canadien — qui a contribué à la réussite du projet. Ces éléments – progrès scientifiques, applications pratiques et collaboration internationale — sont demeurés le fondement du Programme spatial canadien.
Alouette-I a été conçu pour recueillir de l'information et effectuer des recherches en vue d'améliorer les télécommunications entre le nord et le sud du Canada. Alouette-II lui a succédé en 1965, suivi par ISIS I en 1969 et ISIS II en 1971. Ces satellites ont ouvert la voie au lancement d'Anik A1 en 1972, le Canada devenant alors le premier pays à disposer d'un système national de télécommunications par satellite, et d'Hermes en 1976. Hermes était à l'époque le satellite de télécommunications le plus puissant, et le premier à diffuser des signaux de télévision directement aux maisons équipées de petites antennes, à permettre la prestation de services médicaux d'urgence dans les régions éloignées grâce à la télémédecine et à faciliter la téléconférence. L'incidence d'Hermes sur les télécommunications dans le Nord canadien a été particulièrement importante, puisque ce satellite a donné à ses résidents le même accès au téléphone et à la télévision que ceux dont jouissaient les citoyens dans le reste du pays.
Outre les télécommunications, c'est sur l'observation de la Terre que le Canada a rapidement concentré ses efforts dans le domaine spatial. Il a tout d'abord fourni une station terrestre de réception et de traitement pour les premières versions des satellites américains Landsat, ce qui a fait de l'industrie canadienne un chef de file dans le traitement des données recueillies par satellite et le développement d'applications. Plus tard, le Canada a mis au point une technologie d'observation de la Terre par radar adaptée à ses propres besoins, soit l'observation et la surveillance de vastes territoires et voies navigables chargées de glace pendant les longs hivers sombres et nuageux du Nord, ce qui a débouché sur le lancement de RADARSAT-1 en 1995 et de RADARSAT-2 en 2007. Ces satellites-radars sont parmi les plus sophistiqués au monde et fournissent des images détaillées de la surface terrestre de jour comme de nuit, peu importe les conditions météorologiques.

La collaboration du Canada avec les États-Unis dans le cadre de projets spatiaux s'est intensifiée au fil des ans. Dans les années 1960, l'entreprise canadienne Héroux Inc. a produit le train d'atterrissage des modules lunaires du programme Apollo. Dans les années 1970, le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), en partenariat avec Spar Aérospatiale (achetée par la suite par MacDonald, Dettwiler and Associates), a conçu et fabriqué l'emblématique Canadarm, bras télémanipulateur qui, par la suite, a équipé toutes les navettes spatiales américaines et a ouvert la voie aux contributions robotiques du Canada à la Station spatiale internationale : le Canadarm2 en 2001 et le télémanipulateur d'entretien Dextre en 2008.
Pour ce qui est des sciences et de la recherche, le Canada a lancé les petits satellites SCISAT et MOST en 2003, le premier pour surveiller l'amincissement de la couche d'ozone et le second, pour réaliser des observations astronomiques. Des entreprises canadiennes, en particulier COM DEV, ont également fourni l'instrumentation scientifique pour des satellites américains, japonais, suédois et européens.
Contribution du Canada à la Station spatiale internationale
Tout comme les États-Unis, la Russie, l'Europe et le Japon, le Canada est un partenaire de la Station spatiale internationale (SSI), laboratoire de recherche orbital exceptionnel. L'investissement du Canada dans la SSI permet aux chercheurs canadiens d'avoir accès à la Station pour effectuer des recherches au profit des Canadiens.
Depuis le lancement de son premier module en 1998, la SSI fait le tour de la Terre 16 fois par jour à environ 370 km d'altitude et à une vitesse de 28 000 km/h. Elle parcourt quotidiennement une distance correspondant à un aller-retour entre la Terre et la Lune. La SSI a la taille d'un terrain de football et une surface habitable équivalente à celle d'une maison de cinq chambres.
Le Système d'entretien mobile (SEM) — un système robotique de pointe qui a permis d'effectuer l'assemblage de la SSI dans l'espace, un module à la fois — constitue un élément essentiel de la contribution du Canada à la SSI. Élaboré pour l'Agence spatiale canadienne par MacDonald, Dettwiler and Associates à Brampton, en Ontario, le SEM comprend les éléments suivants :
- le Canadarm2, bras robotique de 17 mètres de longueur, qui a joué un rôle crucial dans l'assemblage et l'entretien de la SSI;
- Dextre, le robot bricoleur à deux bras de la Station, que les astronautes et cosmonautes peuvent utiliser pour manipuler des objets délicats et enlever ou remplacer des pièces de la SSI;
- la Base mobile, plateforme mobile et poste d'entreposage.

Enfin, le Canada a envoyé des astronautes dans l'espace plus souvent que tout autre pays, à l'exception des États-Unis et de la Russie, en partie grâce à son importante contribution au programme de la navette spatiale et à la Station spatiale internationale. L'astronaute Chris Hadfield, premier Canadien à avoir fait une sortie dans l'espace, deviendra aussi à la fin de 2012 le premier commandant canadien de la Station spatiale internationale.
Le programme spatial public du Canada a toujours fait appel au savoir-faire et à la collaboration de l'industrie. Les premiers satellites ont été financés et conçus par des ministères fédéraux, mais assemblés essentiellement par des entreprises privées. Les premiers satellites de télécommunications ont été exploités dans le cadre d'un partenariat public-privé, Télésat Canada, qui a été entièrement privatisé en 1993 et est depuis devenu un chef de file mondial dans la prestation de services de télécommunications par satellite. Le secteur privé a dirigé le développement d'applications de données recueillies par satellite et des processus connexes pour répondre aux besoins de levé et de cartographie du gouvernement. Il a aussi dirigé le développement ultérieur de satellites-radars. C'est bien sûr le gouvernement qui a prévu et financé les systèmes robotiques fournis par le Canada pour la navette spatiale et la Station spatiale internationale, mais leur conception et leur fabrication a été assurée par l'industrie.
Importance symbolique de l'espace pour les Canadiens

Selon un reportage du réseau CBC en juin 2008, portant sur un sondage Ipsos-Reid, le Canadarm est considéré comme la plus grande réalisation canadienne de tous les temps, l'emportant sur les soins de santé universels, l'insuline et le téléphone.
En 2013, le Canadarm2 et Dextre figureront sur les billets de cinq dollars, tout comme d'autres thèmes emblématiques de l'identité nationale et des exploits du Canada, par exemple l'innovation en médecine et le chemin de fer qui relie l'est et l'ouest du pays.
En janvier 2011, Postes Canada a émis une série de cinq timbres soulignant la fierté canadienne, dont un illustre le Canadarm.
En avril 2006, la Monnaie royale canadienne a émis une pièce commémorative illustrant le Canadarm et le colonel Chris Hadfield, astronaute canadien.

Le Programme spatial canadien a ensuite été le principal catalyseur de la création d'une industrie spatiale canadienne de 3,4 milliards de dollars qui emploie aujourd'hui quelque 8 000 travailleurs aux quatre coins du pays. Quatre-vingts pour cent des recettes de l'industrie proviennent des services de télécommunications par satellite, et la moitié viennent des ventes à l'étranger (principalement aux États-Unis et en Europe), ce qui fait du secteur spatial canadien l'une des industries spatiales les plus axées sur les exportations au monde.
Figure 2 : Revenus du secteur spatial canadien par sous-secteur, 2010
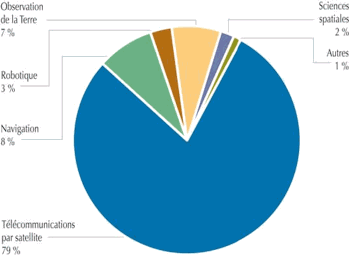
- Les télécommunications par satellite incluent les services de télécommunications de la voix et des données, de radiodiffusion et de télévision.
- Les systèmes mondiaux de navigation par satellite offrent de l'information sur la position, le temps et la navigation aux utilisateurs équipés de récepteurs adéquats.
- Les satellites d'observation de la Terre sont utilisés pour surveiller et protéger l'environnement, gérer les ressources naturelles et assurer la sécurité.
- Le matériel de robotique spatiale est utilisé à l'appui des vols habités et non habités dans l'espace, comme l'exploration du terrain ainsi que la récupération, l'inspection et la réparation de satellites.
- Les entreprises et chercheurs canadiens ont participé à plusieurs missions satellitaires visant des objectifs en sciences spatiales relatifs à la météorologie de l'espace, à l'astronomie et aux sciences environnementales, en vue d'améliorer les capacités technologiques du Canada dans le domaine spatial.
Texte adapté de Hickling Arthurs Low, The State of the Canadian Space Sector, rapport de recherche commandé dans le cadre de l'Examen de l'aérospatiale, août 2012.
Figure 3 : Revenus du secteur spatial canadien, de 2001 à 2010

L'industrie spatiale canadienne est fortement concentrée, avec les 10 plus grandes entreprises générant près de 90 % de l'ensemble des revenus, relativement peu d'entreprises de taille moyenne et quelque 200 organisations de plus petite taille. L'un des points forts de l'industrie a été sa capacité d'établir des créneaux pour son leadership technologique mondial, souvent en exploitant des innovations mises au point dans le cadre de programmes gouvernementaux.
Le Programme spatial canadien est dirigé par l'Agence spatiale canadienne (ASC), établie en 1989 et investie du mandat prescrit par la loi « de promouvoir l'exploitation et l'usage pacifiques de l'espace, de faire progresser la connaissance de l'espace au moyen de la science et de faire en sorte que les Canadiens tirent profit des sciences et techniques spatiales sur les plans tant social qu'économique »Note 3. Le budget annuel de l'ASC en 2011-2012 s'élevait à 425 millions de dollars, dont environ un tiers était des fonds temporaires se rapportant au Plan d'action économique du Canada et à des projets particuliers.
À l'échelle fédérale, le ministère de la Défense nationale, le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources naturelles, le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, le ministère des Pêches et des Océans et le ministère des Affaires autochtones et du Développement du Nord canadien sont les principaux utilisateurs de l'espace. Le gouvernement finance également deux établissements de recherche publics, soit le CNRC et Recherche et développement pour la défense Canada, dont le mandat inclut des activités se rapportant à l'espace.
Enfin, plusieurs institutions académiques participent à la recherche et à l'éducation dans le domaine spatial. Elles veillent à ce que le Canada soit en mesure de former les cerveaux qui imagineront, concevront et fabriqueront les technologies de pointe requises pour répondre aux besoins spatiaux futurs du pays.
Cet éventail d'établissements et d'entreprises est à la fois la cause et l'effet des 50 années de succès du Canada dans l'espace et confère au pays une solide assise pour raffermir et renforcer sa position à une époque où les actifs spatiaux sont de plus en plus importants pour notre prospérité et notre sécurité à long terme. Toutefois, alors que le nombre de puissances spatiales augmente rapidement et que la concurrence est plus féroce que jamais, les politiques et programmes canadiens liés à l'espace semblent manquer de précision, d'orientation ainsi que de rigueur sur le plan de la gestion.